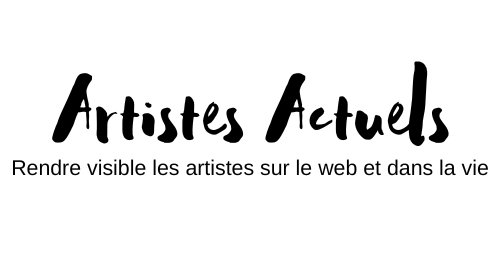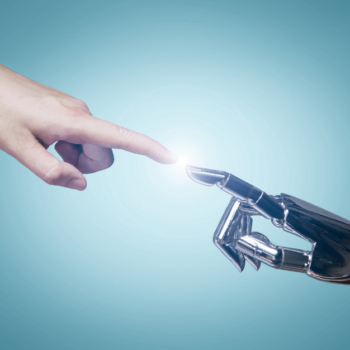Statue de la Liberté : entre symbole et réinterprétations
- Publication publiée :3 février 2025
- Post category:Dossiers art actuel
La Statue de la Liberté, de son nom originel « La liberté éclairant le monde » est devenue un symbole universel de liberté et de démocratie. Comptant parmi les monuments les plus connus au monde, elle a inspiré la pop culture et de nombreux artistes.
Statue de la Liberté, un chef-d'œuvre technique
La Statue de la Liberté émerge de l’imagination du sculpteur français Auguste Bartholdi pour célébrer l’amitié franco-américaine.
En 1875, une souscription publique est lancée qui décrit le projet ainsi :
« Au milieu de la rade de New York, sur un îlot qui appartient à l’Union des États, en face de Long Island, où fut versé le premier sang pour l’indépendance, se dresserait une statue colossale, se dessinant sur l’espace, encadrée à l’horizon par les grandes cités américaines de New York, Jersey City et Brooklyn. Au seuil de ce vaste continent, plein d’une vie nouvelle, où arrivent tous les navires de l’univers, elle surgira du sein des flots elle représentera « La Liberté éclairant le monde.” La nuit, une auréole lumineuse, partant de son front, rayonnera au loin sur la mer immense. »
Dans ses premières esquisses en plâtre, Auguste Bartholdi conçoit une statue qui déjà éclaire le monde le bras droit levé.
Mais elle se tient la jambe gauche avancée, dégageant son pied avec des chaînes tout juste brisées. Dans son bras gauche abaissé, elle tient un morceau de chaine et non la déclaration d’indépendance de 1776.
Pour réaliser la statue, Auguste Bartholdi travaille avec Gustave Eiffel qui en conçoit l’armature interne. Le chantier se tient à Paris et dure presque dix ans. La tête de la statue est présentée au public lors de l’Exposition universelle de 1878.
Avec le style néo-classique, l’artiste se démarque de son époque qui ne met plus à l’honneur ce style depuis près d’un demi-siècle. Sa volonté est de faire référence à la pureté de l’art antique. Femme couronnée de rayons évoquant les divinités solaires antiques et revêtue d’une toge antique, son visage est inexpressif en signe de tranquillité et de puissance.
Monument plutôt qu’œuvre d’art, elle a un rôle éminemment symbolique
Une fois sa construction achevée, elle est livrée en plusieurs parties et après quatre mois d’assemblage, elle est inaugurée le 28 octobre 1886.
Elle devient immédiatement emblématique des Etats-Unis d’Amérique puisqu’on estime à plus de seize millions de migrants venus d’Europe qui passèrent par Ellis Island pour entrer aux Etats-Unis. Il est également avancé que 100 millions d’Etats-Uniens ont aujourd’hui une ou un ancêtre passé par Ellis Island.
La Statue de la Liberté, un symbole facile pour le cinéma et la publicité
Nombreux sont les films dans lesquels des scènes fortes montrent des migrants arrivant par bateau, aux regards aimantés par leur première image des Etats-Unis : la Statue de la liberté.
Ainsi, « The immigrant » de Charlie Chaplin (1917) ou « America, America » d’Elia Kazan (1964) sont deux films mythiques qui reprennent cette thématique. A chaque fois, la séquence est la même : le paquebot entre dans la baie de New York et passe au pied de la Statue de la liberté qui semble saluer de son flambeau. Sur le pont, les passagers sont en groupes compacts. Certains agitent le bras, d’autres se tiennent immobiles, écrasés par l’émotion. Tous espèrent une vie meilleure.
Bientôt, on arrivera également aux Etats-Unis par les airs et les compagnies aériennes s’emparèrent à leur tour de la Statue de la Liberté. Plus tard dans le vingtième siècle, la Statue de la liberté perdra son symbole de porte d’entrée des Etats-Unis pour devenir le symbole du monde libre. Ainsi, les marques emblématiques des Etats-Unis détournèrent la statue comme de nombreuses marques de cigarettes qui portèrent le message qu’une grave addiction était une liberté.
Les jeans Levis s’emparèrent également du symbole, bien au-delà de la seule liberté de mouvement.
De la Liberté conquérante vers la dystopie
De la liberté de mouvement à l’émancipation, la statue souffle un vent émancipateur. On sent cette énergie vitale dans le clip de la reprise de « Go West » des Britanniques de Pet Shop Boys en 1993. Cet hymne de la fierté homosexuelle met en scène une statue de la liberté représentée par une femme noire habillée en rouge.
Mais le plus souvent, la Statue de la liberté est utilisée de façon dystopique pour mettre en scène la menace contre la liberté et la démocratie voire son effondrement.
Ainsi dans « La planète des singes » (1968), l’astronaute Taylor interprété par Charlton Heston finit par arriver sur les vestiges d’une statue de la Liberté échouée sur une plage. Comprenant qu’il est en fait retombé sur Terre et que, durant son long voyage spatial, l’humanité s’est auto-détruite, il s’écroule en maudissant les humains.
De même dans « Batman forever » de Joel Schumacher (1995), un hélicoptère vient se fracasser sur le visage de la Statue de la liberté dans une nuit noire. Nous ne sommes pourtant pas à New York mais à Gotham City où tout n’est que chaos et absence d’espoir.
Les artistes célèbrent la liberté
C’est d’abord le pop art qui s’est emparé de ce symbole de liberté. Ainsi, Andy Warhol représente la statue en jouant avec les couleurs vives et les répétitions dans sa série de 1962 de « Statue of Liberty ». Mais dans le même temps, on s’interroge de savoir si la Statue de la Liberté n’était pas pour le maitre du pop art qu’un objet de consommation comme tous les autres ?
Plus tard en 1986, le street-artiste Keith Haring réalise avec la participation des 1000 jeunes une fresque murale « Liberty banner » commémorant le centenaire de l’arrivée de la Statue de la liberté aux Etats-Unis. Il en réalisera également une version plus petite reprenant ses codes visuels. Au travers de ces deux œuvres, Haring célèbre sans hésitation la célèbre statue et ce qu’elle représente.
C’est animé du même enthousiasme que Salvador Dali réalise en 1972 une Statue de la liberté haute de 7 mètres et qui brandit deux flambeaux en signe de victoire. C’est assurément la liberté qui gagne pour l’artiste Espagnol !
Lorsqu’en 1988, l’artiste français César réalise un Centaure en acier, il y placera à l’intérieur du corps une petite Statue de la Liberté, statue discrète mais au symbolisme très fort.
En 1996 est inaugurée à Vitry-sur-Seine la sculpture monumentale « Chaufferie avec cheminée » imaginée par Dubuffet (décédé en 1985) pour sa Villa Falbala. Haute de 14 mètres, elle est présentée comme « une flamme de résistance et de liberté » et reprend la symbolique de la flamme de la statue.
En 2014, l’artiste chinois Xu Zhen réalise une sculpture présentant 19 personnages de la figuration classique occidentale. Cette œuvre s’intitule « European Thousand Arms Classical Sculpture ». Chaque personnage mesure 2m50 et parmi eux se trouve deux Statues de la liberté.
En 2018, les Etats-Unis offrent après les attentats de 2015 et 2016 à la ville de Paris une œuvre monumentale réalisée par Jeff Koons. Ce « Bouquet of tulips » représente une main tenant des tulipes ballons colorées. Il se compose de onze fleurs, la douzième, manquante, symbolisant les morts des attentats. Jeff Koons invoque l’esprit de Bartholdi en disant « Je voulais faire un geste de soutien et d’amitié entre les peuples américain et français ».
Les artistes envahis par le doute
A côté des artistes qui célèbrent la liberté, d’autres doutent que la Statue de la Liberté puisse encore représenter un idéal de démocratie au sein d’un pays qui ne le porterait plus haut et loin.
Ainsi, lorsqu’en 1986 Bernard Buffet dessine une Statue de la liberté sur un fond bleu-vert hachuré et sombre, ce symbole historique apparait triste et austère, presqu’angoissante.
En 1989, l’artiste britannique Gee Vaucher, auparavant directrice artistique d’un groupe musical, réalise une Statue de la liberté en pleurs intitulée « Oh America ». Cette œuvre très critique sur les Etats-Unis réapparaitra en 2016 lors de la première élection de Donald Trump à la présidence.
Quelques années plus tard, l’artiste originaire de Brooklyn Zaq Landsberg réalise la sculpture « Reclining Liberty » qui met en scène une Statue de la liberté paisiblement couchée dans l’herbe. Sans s’engager dans une contestation violente, l’artiste explique que sa sculpture pose la question à laquelle il faut prendre le temps de réfléchir « à quelle étape de l’Amérique sommes-nous ? ». Nous sommes alors en 2021 et l’artiste s’interroge sur son pays après la pandémie et le premier mandat de Trump.
Aujourd’hui, la question est plus que jamais d’actualité avec une Statue de la liberté qui semble se convertir au « Free speech » et à toutes ses dérives. Le film de 2015 « The man in the high castle » était-il prémonitoire de cette époque avec une statue de la liberté faisant le salut nazi ?


La rédaction
Plaisir et émotion des découvertes artistiques